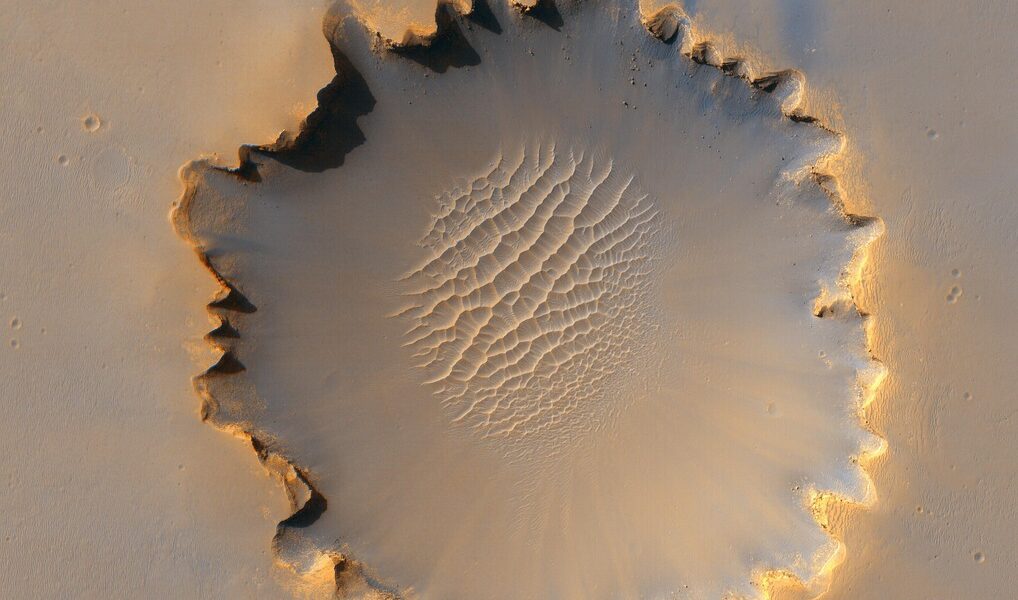
Nouvelle étude révélatrice : décryptage de l’impact carbone de la pêche
|
EN BREF
|
Une nouvelle étude, réalisée par l’association Bloom en collaboration avec le think tank The Shift Project, met en lumière l’empreinte carbone du secteur de la pêche française. Cet exercice inédit révèle que la pêche maritime génère environ 1,1 million de tonnes de CO₂ par an, représentant 0,2% de l’empreinte carbone nationale. Le rapport, fondé sur des données de 2022, identifie la consommation de carburant comme le principal facteur d’émission, représentant 83% du total. Les chalutiers démersaux sont particulièrement responsables, avec près de 46% des émissions. Cette étude vise à fournir une base de données transparente pour éclairer les futures décisions politiques en matière de décarbonation.
Une nouvelle étude conjointe menée par l’association Bloom et le think tank The Shift Project a récemment mis en lumière l’empreinte carbone du secteur de la pêche en France. Pour la première fois, les chercheurs ont appliqué une méthodologie de bilan carbone à la flotte de pêche française, dévoilant des données cruciales concernant les émissions de gaz à effet de serre liées à cette activité. Les résultats révèlent une réalité alarmante quant aux impacts environnementaux, tout en identifiant des leviers d’action pour décarboner le secteur. La pêche, souvent négligée dans les débats sur la transition écologique, requiert aujourd’hui une attention particulière afin de réorienter les politiques publiques et promouvoir des pratiques plus durables.
Table of Contents
ToggleUne méthodologie innovante pour un secteur peu exploré
La méthodologie élaborée par The Shift Project pour réaliser ce bilan carbone est unique en son genre. En effet, il s’agit de la première étude à appliquer un bilan carbone au secteur de la pêche, un exercice qui se base sur les données de 2022. Les chercheurs ont persisté à évaluer l’ensemble des émissions générées par la flotte de pêche française, allant de la construction des navires à leurs retours au port, excluant cependant la transformation et la distribution des produits pêchés. Cette approche permet de mieux visualiser l’impact direct des pratiques de pêche sur l’environnement, en mettant en avant les émissions à chaque étape de leur cycle de vie.
Les chiffres clés de l’empreinte carbone
Selon les résultats de l’analyse, la pêche française génère annuellement 1,1 million de tonnes de CO₂, ce qui représente environ 0,2% de l’empreinte carbone totale du pays. Pour rendre compte de cette problématique, il est judicieux de comparer ce chiffre avec d’autres secteurs : la pêche émet ainsi moins que le secteur du transit aérien en France, qui est estimé à 1,6 million de tonnes en 2023. Précisément, les émissions directes dues à la consommation de carburant représentent 83% du total, tandis que les émissions associées au cycle de vie des navires et des engins de pêche ne représentent que 8% et 5%, respectivement.
Une industrie sous-estimée dans les politiques climatiques
La publication de cette étude est essentielle pour lever le voile sur l’impact écologique souvent ignoré du secteur de la pêche. The Shift Project souligne que l’objectif de cette étude est de constituer un socle de données transparentes et reproductibles, ouvrant la voie à une meilleure compréhension des enjeux environnementaux liés à la pêche. De son côté, l’association Bloom affirme que ce travail met en lumière un angle mort dans les politiques climatiques françaises, soulignant que la pêche est en réalité sous-représentée dans la Stratégie nationale bas carbone.
Analyse approfondie des types d’engins de pêche
Les résultats de l’étude révèlent également des disparités significatives selon les types d’engins de pêche utilisés. Par exemple, les chalutiers démersaux, qui traînent des filets au fond de la mer, sont responsables d’environ 46% des émissions, bien qu’ils ne représentent que 24% des débarquements en volume. Cette empreinte élevée s’explique par la forte consommation de carburant requise par la puissance motrice et le fonctionnement des engins employés. En parallèle, les chaluts et sennes pélagiques affichent 27% des émissions, tandis que les flottilles utilisant des arts dormants comme des casiers et des lignes contribuent à 21% des émissions du secteur.
L’impact environnemental du chalutage de fond
Les effets du chalutage de fond sur l’environnement sont préoccupants. Pour l’étude, les chercheurs ont adapté leur approche afin d’intégrer les perturbations du cycle de carbone sédimentaire. En effet, le chalutage de fond, qui érode les sols marins, déplace le carbone stocké dans les sédiments et perturbe ainsi la pompe biologique de carbone océanique, essentielle pour la régulation du climat. Les estimations révèlent que ces perturbations pourraient représenter jusqu’à 44% des émissions du secteur de la pêche.
Une révélation sur les navires industriels
La taille des navires est également un facteur déterminant pour comprendre l’impact carbone de la pêche. Selon l’étude, les navires industriels de plus de 40 mètres génèrent 29% des émissions, alors qu’ils ne constituent qu’1% de la flotte totale. Cette concentration des émissions met en évidence le déséquilibre entre les grands et petits navires et pose la question de l’équité dans la régulation des pratiques de pêche.
Vers une transition durable dans la pêche
Dans ce contexte, les auteurs de l’étude plaident pour une reconsidération de l’ensemble des politiques publiques de la pêche. Alors que le chalutage de fond représente la technique de pêche la plus subventionnée, l’association Bloom appelle à réorienter les financements vers des pratiques plus durables. Une transition vers la durabilité pourrait impliquer l’adoption de techniques respectueuses de l’environnement et la mise en place de programmes de formation pour aider les pêcheurs à réduire leur empreinte carbone.
Les critiques et défis à relever
Malgré la richesse des données fournies par cette étude, son application dans le réel se heurte à des défis majeurs. L’un des principaux obstacles réside dans l’absence de cadres juridiques adaptés pour accompagner ces nouvelles données. Par ailleurs, les disparités entre les différents types de pêcheurs, notamment entre les grandes industries et les pêcheurs artisanaux, compliquent la mise en place de solutions globales. Une coopération entre les acteurs gouvernementaux, les ONG et les communautés de pêcheurs sera essentielle pour faire évoluer le secteur.
Les perspectives d’amélioration et d’innovation
Pour avancer vers une pêche plus durable, il est crucial d’encourager l’innovation. Cela pourrait inclure le développement de nouveaux types d’engins moins gourmands en carburant, mais également la recherche d’alternatives énergétiques. D’autres propositions pourraient impliquer une meilleure gestion des ressources, l’établissement de quotas de pêche basés sur des critères écologiques et l’amélioration des systèmes de surveillance pour garantir la conformité aux règlements environnementaux.
La sensibilisation comme levier de changement
Une prise de conscience collective est nécessaire pour aborder l’impact environnemental de la pêche. Les acteurs de la filière, les consommateurs et les décideurs politiques doivent être mieux informés sur l’impact environnemental des pratiques de pêche et sur les enjeux liés aux émissions de carbone. Des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur les enjeux climatiques peuvent être mises en œuvre pour inciter les consommateurs à faire des choix éclairés autour de leurs habitudes de consommation des produits de la mer.
Conclusion : un appel à l’action
Cette étude portée par l’association Bloom et The Shift Project souligne l’importance d’une démarche collective pour réduire l’empreinte carbone du secteur de la pêche. Chaque acteur, du pêcheur au consommateur, a un rôle à jouer pour favoriser des pratiques de pêche durables. Les décideurs doivent, quant à eux, s’engager à intégrer ces enjeux dans les politiques publiques pour garantir un avenir respectueux de l’environnement et économiquement viable pour le secteur de la pêche.

Une étude récemment publiée par le think tank The Shift Project et l’association Bloom livre des analyses approfondies concernant l’empreinte carbone du secteur de la pêche en France. Ce bilan carbone unique met en lumière les défis climatiques associés à cette industrie, afin de favoriser une prise de conscience nécessaire parmi les décideurs et le grand public.
La recherche indique que la pêche française génère environ 1,1 million de tonnes de CO₂ chaque année. Ce chiffre représente 0,2% de l’empreinte carbone totale du pays, et souligne l’importance d’agir dans ce secteur. En effet, 83% de ces émissions proviennent de la consommation de carburant, mettant ainsi en exergue la dépendance des activités de pêche aux hydrocarbures.
Les données montrent également que les chalutiers démersaux sont les principaux responsables des émissions, contribuant à presque la moitié des gaz à effet de serre, avec un impact nettement supérieur à celui des autres types de navires de pêche. Ces statistiques alertent sur la nécessité d’une réforme en profondeur des pratiques actuelles pour réduire l’empreinte carbone.
Pour Bloom, cette étude permet de mettre en évidence un « angle mort » dans les politiques climatiques françaises, où le secteur de la pêche ne bénéficie pas d’une stratégie d’action claire malgré ses implications significatives. La publication souligne la nécessité d’intégrer ce domaine dans les discussions sur la transition énergétique et l’avenir écologique.
Un autre aspect crucial de l’étude concerne l’impact du chalutage de fond, qui perturbe les sols marins et déloge le carbone stocké dans les sédiments. Selon les experts, ces émissions pourraient représenter jusqu’à 44% des émissions totales, selon les évaluations. Ces résultats encouragent les acteurs du secteur à repenser leurs méthodes et à adopter des pratiques plus durables.
Il est essentiel de créer un socle de données transparent et reproductible pour éclairer les débats et guider les décisions politiques. Cette étude, en apportant des données factuelles claires, ouvre la voie à une discussion sur les stratégies à adopter pour réduire les émissions de carbone et promouvoir une pêche durable.

Laisser un commentaire