
L’Université de Montréal présente son bilan carbone inaugural
|
EN BREF
|
L’Université de Montréal a récemment dévoilé son premier bilan carbone vérifié pour l’année 2022-2023, estimant ses émissions de gaz à effet de serre à plus de 63 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone. Ce bilan, qui se divise en trois périmètres d’activités, met en lumière les émissions directes, l’utilisation d’électricité achetée et les émissions indirectes liées aux déplacements quotidiens et aux approvisionnements. L’université s’est fixé des objectifs ambitieux pour réduire ces émissions : une baisse de 20 % d’ici 2025 et 40 % d’ici 2030, avec l’objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2040. Cette initiative représente une étape cruciale vers une transition écologique, soutenue par un fonds carbone et un accompagnement des unités de l’établissement pour quantifier et réduire leurs émissions.
Récemment, l’Université de Montréal a franchi une étape décisive dans sa démarche de durabilité en dévoilant son premier bilan carbone vérifié pour l’année 2022-2023. Ce rapport met en lumière les enjeux environnementaux auxquels l’institution se confronte et expose les résultats de ses émissions de gaz à effet de serre (GES). L’Université s’engage à suivre ses progrès vers la carboneutralité, en offrant une feuille de route à ses efforts de réduction d’émissions. Ce bilan constitue une base solide pour évaluer l’impact environnemental des activités de l’Université et pour planifier son avenir durable.
Table of Contents
ToggleDétails des émissions de gaz à effet de serre
Le bilan publié révèle un total de plus de 63 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (t éq. CO2) pour l’année 2022-2023, réparties sur trois périmètres distincts d’activités. Cela donne un cadre complet pour comprendre l’empreinte écologique de l’université.
Émissions directes de l’UdeM
Dans le premier périmètre, se concentrant sur les émissions directes, l’évaluation indique environ 28 400 t éq. CO2. Parmi ces émissions, le chauffage au gaz naturel des bâtiments est le plus significatif, atteignant 26 852 t éq. CO2. De plus, les fuites des systèmes de réfrigération contribuent à hauteur de 1044 t éq. CO2, suivi par les véhicules de service qui ajoutent également leur quota d’émissions.
Émissions liées à l’électricité
Le deuxième périmètre se concentre sur les émissions indirectes liées à l’électricité achetée, qui affichent un bilan modeste de 254 t éq. CO2. Ce résultat étant largement attribuable à l’utilisation de l’hydroélectricité québécoise, qui est une source d’énergie renouvelable et bien moins polluante que les combustibles fossiles.
Emissions indirectes et déplacements
Le troisième périmètre, tenant compte des émissions indirectes, présente un tableau plus vaste. Les déplacements quotidiens des utilisateurs produisent 10 807 t éq. CO2, et les voyages professionnels s’ajoutent à ce bilan avec 2735 t éq. CO2. Cependant, un facteur majeur reste la chaîne d’approvisionnement, avec des émissions de 21 056 t éq. CO2 résultant de l’achat de biens et de services, ainsi que 814 t éq. CO2 pour la gestion des locaux loués.
Une feuille de route vers la carboneutralité
Ce bilan carbone a pour objectif d’accompagner l’UdeM dans son effort de réduire ses émissions. Selon des prêts concernés, tels que Stéphane Béranger, coordonnateur au développement durable, l’Université s’est fixée des objectifs d’amélioration, visant à réduire de 20 % d’ici 2025 par rapport à 2004-2005, suivie d’une diminution de 40 % d’ici 2030. L’étape ultime étant d’atteindre la carboneutralité en 2040.
En prenant l’année de 2004-2005 comme référence, l’université s’aligne avec l’Accord de Paris qui a établi des buts de réduction des GES pour le Canada. Pour arriver à ces cibles proposées, l’UdeM prévoit d’électrifier son système de chauffage. Le remplacement de chaudières opérationnelles au gaz naturel par des chaudières électriques dans certains bâtiments, comme la centrale thermique et le pavillon Marie-Victorin, pourrait engendrer une baisse significative d’émissions, estimée à 5000 t éq. CO2.
Méthodologie du bilan carbone
Les données soutenant ce premier bilan proviennent de différentes unités au sein des campus de l’UdeM, y compris ceux de la montagne, Saint-Hyacinthe et Laval. Les informations ont été analysées méticuleusement par l’Unité du développement durable, qui a également soumis le résultat à un vérificateur externe, Enviro-accès.
Pour renforcer son engagement environnemental, l’Université a également établi un fonds carbone destiné à compenser les émissions de GES liées aux déplacements professionnels du personnel. En parallèle, l’Unité du développement durable a développé un service d’accompagnement afin d’aider les unités et services de l’université à quantifier leurs propres émissions et à mettre en œuvre des plans de réduction efficaces.
Les experts impliqués dans cette démarche se réjouissent de constater que le bilan carbone de l’UdeM s’inscrit dans la moyenne des établissements d’enseignement supérieur québécois. Les résultats seront froidement comparés à d’autres institutions, tels que l’Université McGill, l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval, favorisant ainsi des discussions utiles autour des meilleures pratiques à adopter.
Cette première initiative de bilan carbone vérifié marque une étape importante pour l’UdeM vers une transition écologique, en fournissant une base robuste pour mesurer les progrès futurs et ajuster les stratégies nécessaires à une réduction significative des émissions.
Une application pour mesurer son empreinte carbone
En complément de ces initiatives, l’Unité du développement durable a lancé une application mobile gratuite qui permet à chacun de calculer son empreinte carbone personnelle. Accessible en ligne, cette application permet de suivre les émissions de GES générées lors des déplacements professionnels et quotidiens, ainsi que celles liées à l’alimentation, grâce à une interface intuitive qui permet de photographier ses repas pour fin d’évaluation.
Pour plus d’information et pour télécharger l’application, les membres de la communauté universitaire peuvent dés à présent s’engager plus activement dans les efforts de réduction d’émissions. Cette démarche vise à inciter chacun à devenir acteur du changement en matière de durabilité.
Conclusion ouverte sur l’engagement institutionnel en faveur de l’environnement
Avec cette première publication de son bilan carbone, l’Université de Montréal non seulement confère une importance particulière à ses engagements en matière de développement durable, mais elle fait également un appel à l’action pour ses membres, démontrant ainsi un modèle à suivre dans l’enjeu crucial de la lutte contre le changement climatique. Les résultats et les mesures mises en œuvre présenteront un témoignage de la volonté institutionnelle à intégrer des pratiques écoresponsables au sein de sa structure même.
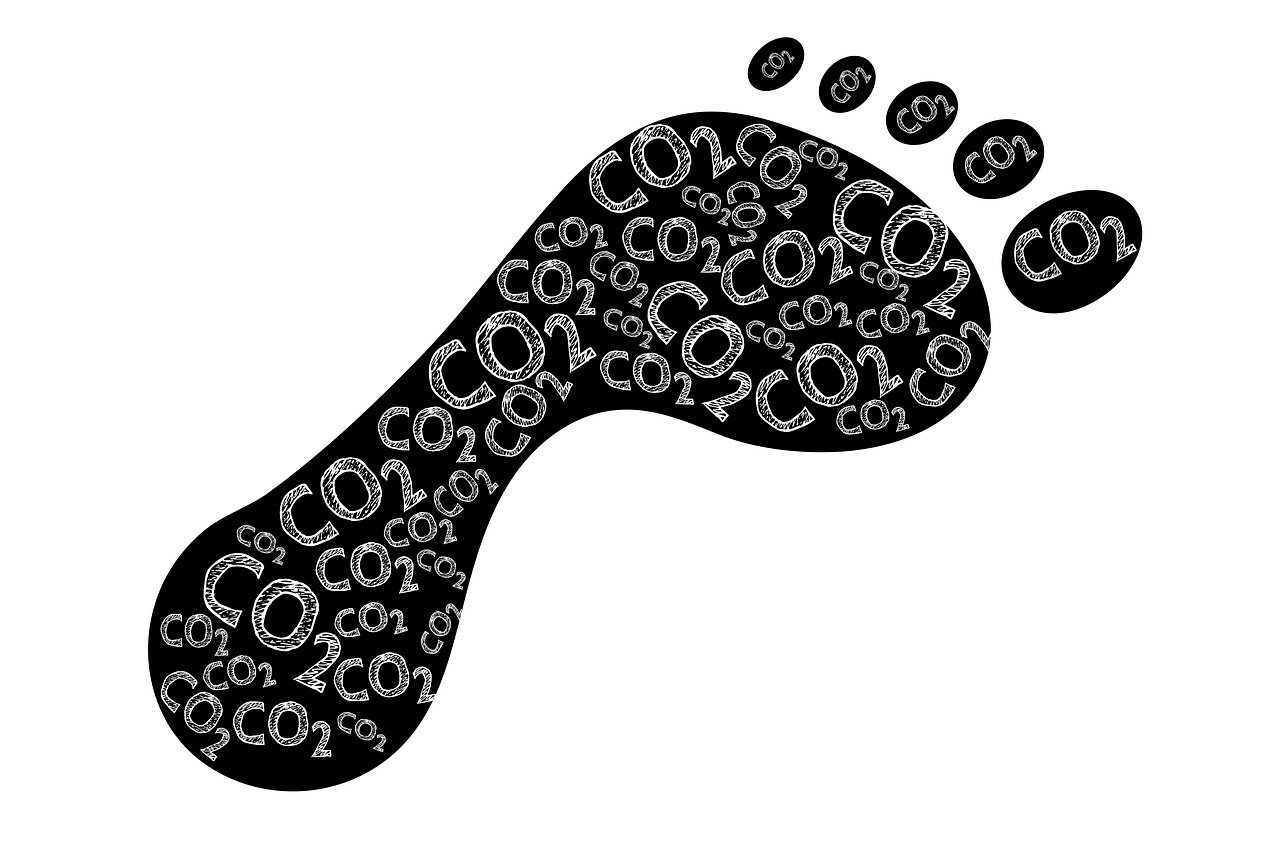
Témoignages sur le bilan carbone inaugural de l’Université de Montréal
Michel, étudiant en sciences environnementales à l’UdeM, exprime sa satisfaction face à cette première publication : « C’est encourageant de voir que notre université prend des mesures concrètes pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cela nous inspire, en tant qu’étudiants, à adopter des comportements plus durables dans notre propre vie. »
Sophie, membre du personnel, ajoute : « La transparence de l’Université à travers ce bilan carbone vérifié est précieuse. Cela montre que nous avons une responsabilité collective vis-à-vis de l’environnement et que chaque action compte dans la lutte contre le changement climatique. »
Jean, professeur de biologie, souligne l’importance de cet engagement : « Ce rapport est essentiel pour évaluer notre impact environnemental et suivre notre chemin vers la carboneutralité. C’est une étape significative qui va motiver les autres institutions à emboîter le pas. »
Émilie, activiste pour le climat, commente : « Quand j’ai entendu parler de ce bilan, j’ai été ravi. Cela démontre que l’Université de Montréal fait de la durabilité sa priorité et que nous pouvons croire en un avenir meilleur pour le mobilier scolaire et nos campus. »
Pour finir, Laurent, un représentant étudiant, conclut : « Ce n’est que le début, et nous espérons que l’université continuera à s’engager pour réduire encore plus ses émissions de CO2 dans les années à venir. Il est encourageant de penser que nous pouvons avoir un impact positif sur notre planète. »

Laisser un commentaire